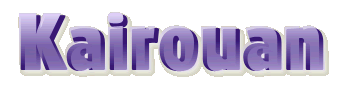
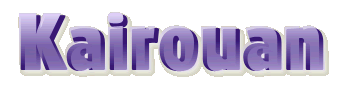
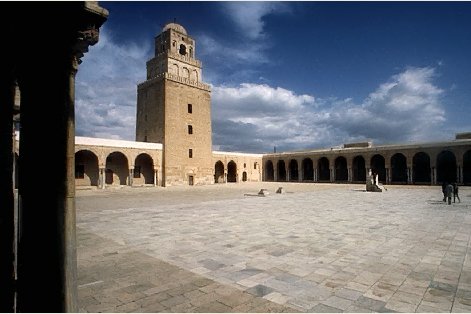 Après
la victoire des Arabes sur les Byzantins en 647, Sidi ‘Uqba ibn
Nafi‘ fonda en 670, à 60 kilomètres de Sousse,
Kairouan ou Qayrawan (terme qui signifie place d’armes).
C’était un campement permanent, à l’abri des
attaques de la flotte byzantine, qui devait servir de base
opérationnelle pour lutter contre les Berbères.
Après
la victoire des Arabes sur les Byzantins en 647, Sidi ‘Uqba ibn
Nafi‘ fonda en 670, à 60 kilomètres de Sousse,
Kairouan ou Qayrawan (terme qui signifie place d’armes).
C’était un campement permanent, à l’abri des
attaques de la flotte byzantine, qui devait servir de base
opérationnelle pour lutter contre les Berbères.
Importante ville de Tunisie (102 000 hab. en 1995), la cité
moderne comporte, comme les autres villes du Maghreb, une kasbah
où se trouvent le centre administratif, les résidences
des notables locaux et les souks regroupant les activités
commerciales et artisanales. Les principales industries sont la
fabrication des tapis et des couvertures de laine. La ville, jadis
réputée pour le travail du cuir et pour celui du
cuivre, fut la capitale musulmane et la résidence des
gouverneurs arabes. Occupée par les Berbères en 689,
elle connut un siècle de révoltes et de luttes contre
les kharidjites. En 772, Yazid ibn Hatim prend possession de
Kairouan, rebâtit la Grande Mosquée, fait
aménager les souks pour chaque corps de métiers et
mérite le surnom de « second fondateur de la ville
». Ibrahim ibn Aghlab reconnaît tout d’abord la
suzeraineté de Harun al-Rashid puis s’affranchit de
Bagdad moyennant un tribut annuel et, à partir de 800,
constitue une dynastie indépendante qui se maintiendra un
siècle. Sous les Aghlabides, Kairouan connaît son
apogée. Pour assurer l’alimentation en eau potable, les
princes de cette dynastie, Ziyadat Allah Ier et Ibrahim, font
construire châteaux d’eau et citernes dont le bassin des
Aghlabides préserve le souvenir. La Grande Mosquée est
l’objet de plusieurs remaniements. Kairouan est aux IXe et Xe
siècles un sanctuaire et une grande ville de commerce.
C’est aussi une ville de science renommée pour son
école de droit malékite et son école de
médecine formée par Ishaq ibn ‘Imran.
Au milieu du Xe siècle, la ville connaît des troubles,
et le calife Isma‘il al-Mansur établit sa
résidence à al-Mansuriya, qu’il avait fait
construire à quelque distance de Kairouan. Au début du
XIe siècle, les Zirides rompent avec les Fatimides ; ils
installent leur résidence à Kairouan en 1048 et
reconnaissent la suzeraineté du califat de Bagdad. Les
Fatimides déclenchent alors l’invasion hilalienne qui
aura de profondes conséquences. Dès lors, le Maghreb
tourne le dos à l’Orient. Kairouan, ruinée en
1057, ne se relèvera pas de ce désastre : la
décadence s’accentue sous la dynastie berbère des
Hafsides (1228-1574). Maltraitée par les princes de Tunis, la
population de Kairouan est en révolte permanente. Depuis la
fin du XVIe siècle et tout au long du XVIIe, la région
devient l’enjeu des rivalités entre Turcs et Espagnols.
En 1702 Husayn ibn ‘Ali, fondateur de la dynastie husaynite,
relève Kairouan de ses ruines, restaure l’enceinte et de
nombreuses mosquées. Après une nouvelle période
de troubles graves au milieu du XVIIIe, la ville devient, en 1784,
« la plus grande ville du royaume après Tunis ».
Vivant sous le contrôle étroit des Turcs Ottomans,
Kairouan conserve son caractère de ville sainte musulmane
où le fanatisme hostile aux chrétiens persiste
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Après la
signature du traité du Bardo (1881), Kairouan sera un des
foyers de la résistance au protectorat français.
L’importance du passé de Kairouan est attestée par
de nombreux édifices. Sidi ‘Uqba fit édifier en
670 une des plus grandioses mosquées du monde musulman. Hasan
ibn Nu‘man remplace l’édifice primitif par une
nouvelle mosquée en 695 ; celle-ci, devenue trop petite, est
agrandie en 723 aux frais de Hisham, le calife omeyyade de Damas, qui
lui fait donner les dimensions de la mosquée actuelle. Le
minaret carré aurait été commencé
à ce moment. Construit en brique du côté nord,
dans l’axe du mihrab, il a 30 mètres de hauteur pour
environ 10 mètres à la base. Le modèle de cette
tour à trois étages en retrait doit être
recherché dans le Phare d’Alexandrie. En 774, le
gouverneur Yazid ibn Hatim fait à son tour abattre toute la
mosquée, à l’exception du mihrab, et la
reconstruit à nouveau. Cet édifice aurait
été remplacé en 836 par un autre, œuvre de
l’Aghlabide Ziyadat Allah. La grande mosquée actuelle ne
comprendrait donc, hormis le mihrab désormais enfermé
entre deux murs et visible à travers une fenêtre
grillagée, aucun élément antérieur au IXe
siècle.
L’ensemble de la cour et de l’oratoire devait avoir
à l’origine les dimensions actuelles (80 mètres de
large et 135 mètres de profondeur) ; un peu plus du tiers
finira par être occupé par la salle de prière.
Celle-ci comprend dix-sept nefs à toit plat orientées
perpendiculairement au mur de la qibla avec une nef centrale plus
haute et plus large. À l’intérieur, 414 colonnes
monolithes, provenant de monuments antiques, supportent le toit plat.
Chaque chapiteau repose sur une imposte qui reçoit la
retombée d’un arc légèrement
outrepassé, des tirants renforçant les piles des arcs
alignés en profondeur. En 836, la salle de prière de
Ziyadat Allah comprend quatre travées dont une plus large au
fond. Devant le mihrab l’intersection de la nef centrale et de
la travée large est surmontée d’une coupole
à larges côtes reposant sur un tambour octogonal aux
faces légèrement concaves dressé sur un massif
carré creusé de niches. En 862, Abu Ibrahim agrandit
l’oratoire de trois travées vers le nord. En 875, Ibrahim
II construit encore trois travées aux dépens de la
cour, également amputée sur les trois autres
côtés par des galeries doubles. Ainsi la salle de
prière s’ouvrira désormais sur la cour par treize
arcs. Au-dessus de l’entrée, une seconde coupole à
côtes sur tambour percé de fenêtres, la qubba Bab
al-Bahw, repose sur un premier tambour carré. La salle de
prière, au terme de ses agrandissements, compte dix
travées et présente un plan basilical où la nef
centrale et la travée terminale font apparaître un
tracé en T. Les épais murs en brique, dotés de
contreforts, sont percés de quatorze portes. À
l’est, un porche couvert d’une coupole à
côtes, le Bab Lalla Rayhana, s’ouvre dans un saillant
carré. Les influences de l’art ‘abbasside se
traduisent par l’emploi de carreaux de faïence à
reflets métalliques analogues à ceux de Samarra, par
l’usage du défoncement des façades en niche plate
ou en cul de four et par des trompes pour le passage du carré
au polygone. La Grande Mosquée de Kairouan est
l’œuvre capitale du Maghreb, comme la Grande Mosquée
de Cordoue l’est de l’Espagne.
À l’époque aghlabide appartient le petit oratoire
connu sous le nom de mosquée des Trois-Portes,
élevé en 866 ; il comporte une façade à
arcatures en fer à cheval et trois nefs divisées en
profondeur par trois travées. Trois autres monuments sont
à signaler à Kairouan : la Zawiya de Sidi Sahib, dite
mosquée du Barbier, datant du Ier siècle, a
été remaniée au XVIIe siècle ;
l’agréable ensemble architectural actuel, œuvre de
Hammuda bey, comprend une medersa, un oratoire et un tombeau ;
à la Zawiya de Sidi Abeid al-Ghayrani, construite
peut-être par un prince hafside en 1325, la salle de
prière est divisée en trois nefs transversales, et le
tombeau du saint s’élève près du mihrab. Le
plus récent des monuments religieux est la Zawiya Sidi
‘Ameur Abbada ; connue sous le nom de mosquée des Sabres,
elle contient la sépulture d’un santon mort en 1871. La
construction est remarquable par ses cinq coupoles à
côtes reposant sur le cube par un tambour polygonal
percé de fenêtres. Les défenses primitives de la
ville, élevées au VIIIe siècle, ont
été démolies à plusieurs reprises mais
l’enceinte actuelle, qui remonte au XVIIIe siècle,
présente encore un caractère très
médiéval, avec ses portes coudées comme Bab
al-Khukha et ses murs de brique flanqués de contreforts et de
saillants semi-circulaires reliés par un chemin de ronde que
protège un parapet à merlons.