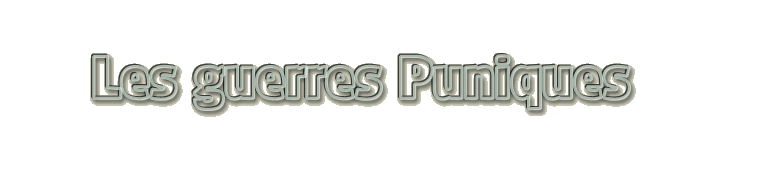
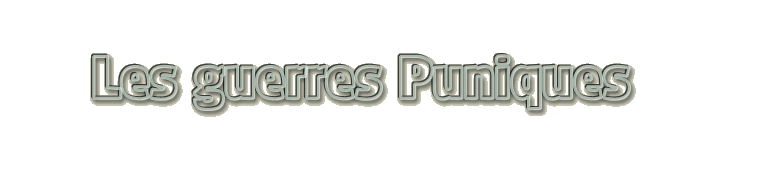
On appelle guerres puniques le conflit qui opposa Carthage
à Rome, de 264 à 146 avant J.-C., et qui se termina par
la destruction de Carthage. L’emploi de cette expression
implique qu’on adopte le point de vue romain, le seul qui soit
connu, puisque tous les témoignages émanent
d’historiens latins (le principal est Tite-Live) ou de Grecs
amis de Rome, comme Polybe qui assista à la destruction de
Carthage. Le conflit comprend trois phases actives. La
première est une lutte pour la possession de la Sicile, qui
s’achève au bénéfice de Rome. La
deuxième est une tentative de revanche menée par une
famille carthaginoise, les Barcides. Si Hannibal essaie de briser la
« confédération italique » et y parvient
presque, Rome reprend le dessus et règle l’affaire en
Afrique même. Carthage n’est plus dès lors
qu’un État vassal. Enfin, Rome décide un jour,
pour des raisons malaisément compréhensibles, de la
détruire. Il lui faut alors trois ans pour venir à bout
de la résistance désespérée d’un
peuple qui démontrera sa vitalité en maintenant sa
civilisation pendant plusieurs siècles.
Cette crise représente un tournant dans
l’évolution du monde méditerranéen antique.
Polybe remarquait déjà qu’elle avait
décidé du sort du bassin oriental, dominé depuis
Alexandre par les États gréco-macédoniens,
autant que de celui du bassin occidental ; il souligne aussi que les
moyens employés par les adversaires ont été
beaucoup plus importants que ceux qui ont été mis en
œuvre dans toutes les guerres antérieures, y compris
celles d’Alexandre. A. J. Toynbee compare les guerres puniques
aux guerres mondiales du XXe siècle : elles ont
entraîné une transformation radicale, politique et
sociale, de tous les peuples qui s’y sont trouvés
impliqués. Pour Rome, elles marquent le passage de la
première phase de l’impérialisme, limitée
à l’Italie, à la seconde, dont l’objectif est
la domination du monde antique. Elles entraînent une
transformation des relations entre Rome et les Italiens, qui aboutira
à la mort de la cité romaine élargie,
façonnée par la conquête du IVe siècle, et
à l’éclosion du premier État
véritable. Avant d’entraîner sa mort politique, la
crise avait transformé Carthage peut-être plus
profondément que Rome ; malheureusement, nous sommes fort mal
instruits de ces changements, que certains historiens modernes vont
jusqu’à nier. Il nous apparaît pourtant que les
Barcides ont engagé l’ensemble de l’État
punique sur des voies tout à fait nouvelles, en profitant des
conséquences de la grande secousse que nous appelons la guerre
des mercenaires, en réalité un début de
révolution sociale, de même nature que les
révoltes d’esclaves qui agitèrent au IIIe et au
IIe siècle l’Asie Mineure, la Sicile et bien
d’autres parties du monde méditerranéen. Si
Hannibal avait vaincu, il aurait sans doute fondé un empire
universel plus ou moins analogue à celui d’Alexandre,
où une large place eût été laissée
aux forces démocratiques, aux dépens des oligarchies de
possédants, qui presque partout soutinrent Rome. Malgré
son échec, certaines leçons n’ont pas
été perdues, et son principal adversaire, Scipion, est
sans doute celui qui en profita le plus. Après lui, Carthage
est devenue, selon le témoignage formel de Polybe, une
démocratie avancée dont les audaces effrayèrent
le Sénat romain au point de lui faire décider sa
suppression.
Rome à la conquête de
la mer
Le monde hellénique s’était jusque-là
presque entièrement désintéressé des
affaires d’Occident ; personne n’imaginait qu’une
puissance fondée à l’ouest de l’Adriatique
pût devenir dangereuse pour les Grecs : après la
défaite d’Hannibal, les Hellènes
découvrirent qu’ils étaient à la merci de
Rome. Même Philippe V de Macédoine, qui conclut une
alliance avec les Carthaginois après Cannes, ne cherchait
qu’à se débarrasser des quelques bases que les
Romains avaient établies sur la côte orientale de
l’Adriatique. Hannibal était un des seuls à
comprendre que les affaires des deux parties de la
Méditerranée étaient inséparables. La
surprise des Grecs, quand ils s’aperçurent que la guerre
entre Rome et Carthage avait scellé leur destin, est
comparable à celle des Européens et des
Américains devant le réveil du Tiers Monde à la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les peuples civilisés de l’Occident faisaient leur
entrée sur le théâtre de la grande politique,
mais des peuples « barbares » (Ibères, Celtes et
Numides), c’est-à-dire étrangers à la
communauté culturelle établie autour de
l’hellénisme, à laquelle Carthage et Rome
étaient intégrées, avaient joué un
rôle important. Pendant la première guerre encore, ces
peuples furent utilisés par Carthage comme des réserves
de mercenaires. Les Barcides eurent l’idée d’en
faire des instruments politiques, en se servant de leurs propres
tendances : ainsi l’empire espagnol d’Amilcar fut
essentiellement un royaume ibère, dont le
général carthaginois était le roi, reconnu par
un congrès des chefs de tribu. Plus tard, Hannibal profitera
de la poussée celtique vers le sud pour briser
l’armée romaine. À la fin de la seconde guerre,
les Scipions, après s’être substitués aux
Barcides à la tête du royaume espagnol,
tournèrent le nationalisme numide contre Carthage. Les
résultats de cet engagement dans la grande politique
méditerranéenne n’ont d’ailleurs pas
été en général favorables au
développement de ces nations. L’essor de la civilisation
ibérique, qui promettait d’être très
brillante, fut brisé net par les conquêtes punique et
romaine. La Gaule connut après le passage d’Hannibal de
grandes transformations politiques et économiques probablement
liées entre elles, et qui sont peut-être la
conséquence directe de la politique barcide : introduction de
la monnaie et constitution de l’empire des rois arvernes ; mais
l’intervention romaine au-delà des Alpes, elle aussi
conséquence de la crise, aboutira promptement à la
vassalisation politique et économique de la nation. Le royaume
numide lui-même ne prit qu’en apparence un brillant
départ sous Massinissa : là encore, la
suzeraineté romaine se révéla être un
obstacle insurmontable à l’épanouissement
d’une nation.
Un enjeu : la
Sicile
Le problème des origines de la première guerre
punique est l’un des plus difficiles et des plus importants de
l’histoire ancienne et, plus précisément, de
l’histoire romaine. Les deux puissances sont en effet
entrées en conflit pour la Sicile. Or, Carthage avait depuis
plusieurs siècles des intérêts essentiels dans
cette île, dont la géopolitique démontre la
nécessaire et étroite liaison avec l’actuelle
Tunisie. À plusieurs reprises, les Carthaginois avaient
tenté de la subjuguer tout entière ; leurs efforts
avaient échoué devant la résistance des Grecs
maîtres de l’est de l’île et rassemblés
par les souverains de Syracuse ; mais, depuis le début du IIIe
siècle, Syracuse n’échappait pas à la
dégénérescence générale de
l’hellénisme occidental, et Carthage exerçait sur
l’ensemble de l’île une hégémonie de
fait. Il est donc normal que la république punique ait
défendu son bien, et l’on peut même
s’étonner qu’elle ne l’ait pas fait avec plus
de détermination et d’efficacité. Au contraire,
l’intervention de Rome au-delà du détroit de
Messine paraît à première vue plutôt
paradoxale. Certes, la guerre contre Pyrrhos (278-276) lui avait
permis d’achever l’unité de l’Italie en
soumettant les villes grecques du Sud. Mais l’organisation
qu’elle avait bâtie, appelée
confédération italique bien qu’elle ne
possédât pas d’organes communautaires et que chacun
des participants non romains fût lié à Rome par
un accord individuel, ne paraît pas, à la
majorité des historiens modernes, avoir eu de vocation
impérialiste.
On insiste en particulier sur le caractère très
primitif de l’économie du territoire romain proprement
dit, qui coupe en deux la Péninsule en son milieu, de la mer
Tyrrhénienne à l’Adriatique : c’est une
économie essentiellement paysanne, qui vient de
découvrir la monnaie sous une forme particulièrement
incommode, celle de l’aes grave . On insiste également
sur l’absence complète de marine, l’inexistence de
relations diplomatiques avec l’outre-mer. Rome se serait
trouvée attirée en Sicile par un enchaînement de
circonstances et d’incidents mineurs et aurait en quelque sorte
conquis l’île malgré elle, sans en avoir une
conscience très nette, par le seul poids de son énorme
force militaire ; les premières réactions des Puniques,
consistant en raids de corsaires sur les côtes italiennes,
auraient amené les sénateurs à surestimer la
puissance de Carthage et à y voir un danger, en fait
inexistant, pour la sécurité de l’Italie. Telle
est la thèse développée notamment, en 1949, par
l’historien allemand A. Heuss.
Depuis lors cependant, une autre interprétation tend à
s’imposer, qui trouve son origine dans les recherches de J.
Heurgon, publiées en 1942, sur les rapports de Rome et de
Capoue : elles font apparaître que le point de départ de
l’impérialisme romain a été la conclusion,
vers le milieu du IVe siècle avant J.-C., d’une union
politique entre Rome et la Campanie, qui a donné naissance,
dans les premiers temps, à un « État
romano-campanien » où les deux partenaires se trouvaient
sur pied d’égalité. Or, si Rome demeurait
économiquement arriérée, la Campanie, et en
particulier Capoue, était l’un des principaux centres
industriels et commerciaux de la Méditerranée. Des
liens étroits s’étaient formés entre les
classes dirigeantes de Rome et de Capoue, des Campaniens venant
siéger au Sénat romain, et des familles romaines, comme
les Claudii, s’engageant dans les affaires du Sud. L’image
de la société romaine, au début du IIIe
siècle, apparaît ainsi beaucoup plus complexe qu’on
ne le croyait, comme l’a montré, en 1962, F. Cassola : si
certaines familles nobles, comme les Fabii, demeuraient
attachées à une politique exclusivement terrienne,
d’autres montraient un esprit plus ouvert et plus hardi. On
constate d’autre part que les Osques, qui constituaient le fond
de la population campanienne, avaient entrepris dès le IVe
siècle la conquête de la Sicile, en s’y infiltrant
comme mercenaires. Vers 285, une de leurs bandes s’était
emparée de Messine. Or, c’est à l’appel de
ces Mamertins que les Romains interviendront dans l’île.
Il est donc vraisemblable que la conquête de la Sicile a
été décidée par le parti qui, dans le
Sénat romain, soutenait les intérêts des
Campaniens ; elle fut commencée par un consul qui appartenait
à la famille des Claudii, la plus importante de ce parti,
alors que la principale famille du parti adverse, celle des Fabii,
connaissait une éclipse.
La partie qui s’engage alors (264 av. J.-C.) met en
présence quatre joueurs : outre Carthage et Rome, les
Mamertins et les Grecs de Sicile orientale, rassemblés par un
général habile, Hiéron, qui ne tardera pas
à se proclamer roi à Syracuse. Hiéron, parvenu
au pouvoir en 270, a pour but d’éliminer les Mamertins
qui mettaient en coupe réglée les cités
voisines. Devant les succès de Hiéron, les Mamertins
font appel d’abord aux Carthaginois qui occupent Messine, puis,
lassés de leur présence, aux Romains qui
éliminent par surprise la garnison punique. Carthage et
Syracuse se retrouvent alors dans le même camp, contre Rome et
les Mamertins ; mais Hiéron, exposé le premier aux
coups des légions, comprend vite qui est le plus fort : en
sacrifiant une partie de son royaume, il achète une
tranquillité qui durera un demi-siècle,
jusqu’à sa mort.
La première guerre
punique
Le conflit pouvait prendre fin sur ces bases, Rome gardant Messine
et le protectorat de Syracuse, et Carthage conservant le domaine qui
est sien depuis la fin du Ve siècle. Or, le gouvernement
punique, qui n’a pratiquement pas agi jusque-là, se met
à concentrer des forces importantes à Agrigente. Les
Romains prennent l’offensive et se rendent maîtres
d’Agrigente après un siège de sept mois (262) ; de
nombreuses villes siciliennes se rallient à Rome.
Carthage adopte alors une nouvelle tactique : obligée de
reconnaître la supériorité romaine en rase
campagne, elle enferme ses armées dans des forteresses et
réserve l’offensive à sa flotte qui multiplie les
raids contre les ports siciliens ralliés à Rome, et
même contre les côtes italiennes. Pendant cinq ans,
jusqu’en 256, les positions ne varient guère dans
l’île. Mais, dès 260, un événement
capital s’est produit : Rome a constitué une flotte et le
consul Duilius a détruit une escadre punique à Mylae.
La tradition romaine présente cette création d’une
marine comme une innovation complète (on aurait copié
des vaisseaux puniques échoués) et attribue à
Duilius une invention technique, celle des « corbeaux »,
passerelles d’abordage munies de grappins, qui auraient
neutralisé la supériorité
manœuvrière des pilotes puniques. En
réalité, les Romains disposaient d’arsenaux bien
équipés et de pilotes expérimentés dans
les ports grecs d’Italie méridionale et sans doute aussi
chez les Étrusques ; mais ils ont cherché à
minimiser le rôle certainement très important
joué par ces alliés dans la victoire.
Cependant, l’établissement d’un équilibre
naval entre les belligérants n’a pas de
conséquences immédiates sur le déroulement de la
guerre en Sicile. Un des consuls de 256, Regulus, propose alors
d’obliger Carthage à capituler en allant l’attaquer
chez elle, en Afrique, suivant l’exemple donné, en 310,
par le roi de Syracuse Agathocle. Marcus Atilius Regulus, que la
tradition présente comme le type du « vieux Romain
», est en réalité, comme l’a montré J.
Heurgon, un de ces sénateurs d’origine campanienne qui
préconisent une politique hardiment impérialiste. Son
débarquement au cap Bon, dans la région la plus riche
du territoire africain de Carthage, prend au dépourvu les
Puniques et leur inflige les plus lourdes pertes : depuis une
quinzaine d’années, on fouille à la pointe de la
péninsule une petite ville détruite alors par
l’armée romaine et abandonnée par la suite ; le
luxe des maisons de cette « Pompéi punique »,
appelée aujourd’hui Kerkouane ou Dar es-Safi, donne une
idée de la prospérité de la république
africaine et de la gravité des dommages que lui causa la
guerre. Cependant, Carthage parvint à se débarrasser de
Regulus, grâce à un condottiere spartiate nommé
Xanthippe. La captivité du consul fournit à la
propagande de guerre romaine des thèmes longuement
exploités.
L’échec de Regulus fut compensé en 254 par la
prise de Palerme, capitale de la province punique en Sicile. Les
Carthaginois ne tenaient plus désormais que quelques
forteresses à la pointe occidentale de l’île. Mais
ils reprirent l’avantage sur mer : en 249, une flotte romaine
fut écrasée devant Drepanum, aujourd’hui Trapani ;
bien soutenues par la marine, les garnisons d’Éryx et de
Lilybée défiaient les assiégeants. À
partir de 247, un jeune général, Amilcar Barca,
organisa une guerre de commandos qui retarda la mainmise totale des
Romains sur l’île.
Le pourrissement de la guerre lassait les deux adversaires. À
Rome, les Fabii revinrent au consulat, et l’on n’envoya
plus en Sicile que des forces réduites. À Carthage, le
parti des grands propriétaires fit donner la priorité
à l’extension vers l’intérieur de
l’Afrique. Cependant, les « capitalistes » romains
obtinrent, en 241, d’équiper à leurs frais une
nouvelle flotte. À sa tête, le consul Lutatius Catulus
intercepta aux îles Égates le convoi qui ravitaillait
les places puniques de Sicile et détruisit l’escadre qui
le protégeait. Le gouvernement punique estima qu’il
n’avait plus les moyens de reconstituer une flotte et demanda la
paix.
Les exigences romaines furent modérées : Carthage
perdait la Sicile et devait verser une lourde indemnité, mais
conservait ses autres possessions extérieures, y compris la
Sardaigne, ainsi que la totalité de son empire africain. Mais
la défaite allait déclencher une crise interne,
politique et sociale, d’une extrême gravité : la
responsabilité en incombait incontestablement au régime
oligarchique, établi au cours du siècle
précédent, qui avait, par avarice ou négligence,
refusé à la marine et à l’armée les
moyens nécessaires, désorganisé le commandement
par la cruauté de la discipline imposée aux
généraux (les vaincus étaient
régulièrement crucifiés, à moins que
leurs relations politiques ne leur permissent de se tirer
d’affaire), et qui n’avait pas su tirer parti de relations
diplomatiques beaucoup plus étendues que celles de Rome.
Contre la classe dirigeante se dressaient maintenant une foule
d’adversaires : d’une part, un prolétariat
composé des paysans libyens asservis, qui allait trouver une
« aile marchante » dans la masse des mercenaires auxquels
le gouvernement punique refusait de payer les arriérés
de solde ; d’autre part, les citoyens des classes moyennes et
inférieures que la décadence de la marine atteignait
directement dans leurs intérêts économiques ;
enfin, les militaires et les « nationalistes ». Amilcar
Barca, qui représentait cette dernière tendance, sut
profiter de la révolte des mercenaires et des paysans pour se
faire donner le commandement de l’armée et, bien
qu’il connût souvent des échecs, put s’imposer
comme le maître de Carthage avec l’appui du parti
populaire. Rome, inquiète à juste titre de son
ascension, réagit en annexant brutalement la Sardaigne dont la
population était en grande partie punique ou «
punicisée » ; ainsi se trouvait définitivement
anéanti tout espoir de réconciliation entre les deux
adversaires.
Le nouvel empire punique
Les Barcides et la seconde guerre
Toute la politique d’Amilcar consiste dès lors à
préparer la revanche en réunissant les moyens
militaires et économiques qui avaient fait défaut
pendant la première guerre, et en se donnant une
indépendance politique qui lui permet d’échapper
au contrôle du gouvernement légal de Carthage,
d’ailleurs aux mains de ses amis. Pour cela, il crée en
Espagne un véritable royaume indépendant, riche des
ressources minières de la Péninsule, et une
armée composée pour l’essentiel des redoutables
guerriers ibériques et toute dévouée à sa
personne et à sa famille (237-229). Après sa mort, la
tâche est poursuivie d’abord par son gendre, Asdrubal,
plus prudent à l’égard de Rome, puis par son fils,
Hannibal, qui, au contraire, adopte dès son avènement,
en 221, une attitude intransigeante.
La question des rapports diplomatiques entre Rome, qui a longtemps
méconnu le péril, et l’État barcide est
obscure ; mais il n’est pas douteux que la destruction de
Sagonte, ville ibérique protégée par Rome,
constitue un casus belli qu’Hannibal a
délibérément accepté. Il a en effet
formé un plan extrêmement logique pour briser la force
romaine. Il s’agit de dissoudre la confédération
italique en utilisant les divergences d’intérêts
qui commencent à opposer Rome à ses alliés
campaniens ou grecs italiotes ; Rome sera ainsi privée de sa
puissance maritime et Carthage pourra reprendre le contrôle de
la Méditerranée. La condition première est la
neutralisation de l’armée romaine. Hannibal compte y
parvenir en utilisant la force d’expansion des Celtes que la
pression des Belges pousse à ce moment vers le sud et
l’ouest. C’est pourquoi il attaque l’Italie par terre,
à travers la Gaule méridionale et les Alpes.
Malgré les fatigues de cette longue marche d’approche et
bien que les Gaulois cisalpins n’aient pas bougé,
Hannibal parvient avec l’aide des Celtes de la plaine padane
à écraser les légions à la Trébie
(218), à Trasimène (217) et surtout à Cannes
(216). Capoue se détache alors de Rome, puis c’est le
tour de Tarente et de Syracuse. Malheureusement pour Hannibal, ces
défections s’échelonnent ; Rome parvient à
maintenir autour d’elle l’essentiel de l’Italie
centrale, et fait preuve d’une extraordinaire
énergie.
D’autre part, une famille qui avait déjà, pendant
la première guerre, mené une politique activement
impérialiste, celle des Cornelii Scipiones, retourne contre
les Barcides leurs propres méthodes et provoque en peu de
temps l’écroulement de l’empire espagnol. Asdrubal,
frère cadet d’Hannibal, parvient bien à
s’échapper. Plus tard, il essaiera de rejoindre
l’Italie à travers la Gaule, mais il est tué sur
le Métaure avant d’avoir pu opérer la jonction
(207). Rome a entre-temps repris Capoue, Syracuse, Tarente, et le roi
de Macédoine, Philippe V, n’a pas compris
l’intérêt qu’il aurait eu à soutenir
efficacement les Carthaginois. Publius Scipion porte alors la guerre
en Afrique en utilisant contre Carthage l’ambition et
l’énergie du roi numide Massinissa ; quand Hannibal
revient dans sa patrie, après plus de trente ans
d’absence, c’est pour se faire battre sous les murs de
Zama, la capitale numide.
Démocratisation de
l’État punique
La paix dictée par Scipion réduit cette fois
Carthage à la condition d’un État vassal de Rome,
mais lui laisse la totalité de son territoire africain.
Hannibal n’a pas perdu tout espoir : voyant Rome s’engager
en Orient, il pense que Carthage pourra se relever avec l’aide
des rois macédoniens, et surtout du monarque séleucide
Antiochos III le Grand qui a rétabli son autorité sur
presque toute l’Asie jusqu’aux frontières de
l’Inde. Pour mettre son pays en état de jouer un
rôle, le Barcide entreprend de compléter la
révolution démocratique commencée par son
père. Mais Rome intervient et l’oblige à
s’exiler ; sa vie s’achèvera en Orient, où il
verra s’effondrer sa politique. Après son départ,
Carthage doit faire face aux ambitions de Massinissa, qui tente
d’unifier l’Afrique sous son sceptre. Mais Rome soutient
mollement le roi, et Carthage a l’habileté
d’améliorer assez la condition des paysans libyens de son
territoire pour qu’ils ne soient pas tentés de faire
défection. Ce sont au contraire des Numides rebelles à
Massinissa qui souvent passent en territoire punique. En revanche,
certains Carthaginois envisageaient sans répugnance de devenir
les sujets du roi ; ils avaient à leur tête un certain
Hannibal l’Étourneau et un Asdrubal, fils d’un noble
punique et d’une fille de Massinissa. Ce parti jouit d’une
importante autorité dans les années 170 à
155.
C’est vers 155 que Rome changea complètement de
politique. Un parti, dont Caton était le représentant
le plus influent, proclamait à toute occasion : « Il faut
détruire Carthage ! » Scipion l’Africain
était mort en 183 en même temps qu’Hannibal ;
certains membres de son parti et de sa famille continuaient encore
à soutenir, comme il l’avait fait, qu’il fallait
respecter les engagements pris envers l’ennemie vaincue. Mais
une propagande active créait à Rome une
véritable haine du Punique qui jusque-là n’avait
pas existé : c’est à ce moment, en particulier,
que se développa la légende de la « perfidie
punique ».
Les Anciens n’ayant pas expliqué ce revirement, les
Modernes se partagent entre plusieurs interprétations.
Certains, comme l’historien allemand W. Hoffmann,
l’expliquent par l’évolution propre de
l’impérialisme romain : sitôt après la
seconde guerre punique, et la guerre de Macédoine qui
l’avait suivie immédiatement, Rome aurait
rêvé d’un monde méditerranéen
composé d’États libres sous sa direction. Les
déceptions soulevées par cette politique et
l’évolution économique (attrait exercé sur
les hommes d’affaires romains par une sorte de capitalisme
fondé sur la grande propriété et le commerce
maritime de denrées chères) amènent la
génération suivante à remplacer le protectorat
par la domination directe fondée sur la terreur. Mais on
comprend mal que des hommes réalistes comme Caton en viennent
à déclencher sans raison précise une guerre dure
et sans profit : Rome n’était pas préparée
à prendre le contrôle de l’économie
africaine qu’elle laissera dépérir après sa
victoire. S. Gsell pensait, quant à lui, que
c’était la crainte de voir Massinissa s’emparer de
Carthage qui avait incité Rome à la détruire.
Cette opinion a été réfutée par B. H.
Warmington : en fait, le danger d’une annexion par les Numides
était bien plus grand vers 160 que dix ans plus tard, au
moment où les partisans du roi avaient perdu leur
crédit dans la ville, et où lui-même arrivait au
terme d’une longue vie.
Nous avons essayé de montrer que la décision de Rome a
été déterminée par l’arrivée
au pouvoir à Carthage d’un parti démocratique
radical en 155. Ce parti adopte une politique agressive à
l’égard du royaume numide, et l’un de ses chefs,
Carthalon, réussit à soulever ses paysans contre le
roi. Il y avait donc un danger révolutionnaire réel en
Afrique. Au même moment, un phénomène analogue se
produisait en Grèce, où la Ligue achéenne,
traditionnellement conservatrice et alliée fidèle de
Rome, tombait sous la coupe des démocrates extrémistes.
Rome réagit dans les deux cas de la même manière
en détruisant complètement la ville (en Grèce,
Corinthe) qui était le principal foyer de
l’agitation.
La fin de Carthage (146 av.
J.-C.)
Lorsque les Carthaginois se rendirent compte que Rome les avait
condamnés, la peur les fit chasser les chefs démocrates
et rendre le pouvoir au parti aristocratique, qui se remit à
la discrétion de Rome en prononçant la formule de la
deditio . Dans ce cas, les déditices devenaient
propriété du peuple romain, mais celui-ci leur laissait
en général la liberté et l’usage de leurs
biens ; en l’occurrence, les consuls, après avoir
procédé au désarmement des Puniques, leur
ordonnèrent d’abandonner Carthage et d’aller fonder
une nouvelle ville dans l’intérieur des terres. Cette
exigence était inspirée par la philosophie
platonicienne qui enseignait que le voisinage de la mer
développe dans les cités la tendance au désordre
: il s’agissait en somme de guérir les Carthaginois des
défauts qui, selon les Romains, les empêchaient de
s’intégrer dans un ordre raisonnable. Ces bonnes
intentions ne furent pas appréciées. Le peuple massacra
les partisans de la capitulation, rappela les chefs populaires et,
dans un immense élan d’énergie et de
solidarité, reconstitua les armements qu’il venait de
livrer. Pendant deux ans, les légions, commandées par
des chefs médiocres, demeurèrent immobilisées
sous les puissantes fortifications et subirent même dans
l’intérieur de cuisants échecs de la part des
armées puniques qui continuaient à tenir le plat pays.
La triste gloire de mettre fin à la guerre fut
réservée au fils de Paul Émile, le vainqueur de
la Macédoine, passé par adoption dans la famille des
Scipions et connu de ce fait sous le nom de Scipion Émilien.
Le récit de la prise de Carthage avait été fait
par Polybe qui en fut le témoin ; il nous est parvenu par
l’intermédiaire d’Appien. Au printemps de 146, les
légionnaires réussirent à forcer l’enceinte
des ports dans le quartier appelé aujourd’hui
Salammbô. Une terrible bataille de rues s’acheva par
l’incendie du temple d’Eshmoun. La résistance avait
été dirigée par un chef démocrate
nommé Asdrubal, que les sources accusent de s’être
comporté en tyran.
Le sol fut voué aux dieux infernaux et semé de sel, les
survivants vendus comme esclaves. Les fouilles modernes ont
rencontré, en plusieurs points du site de Carthage,
l’épaisse couche de cendres de l’incendie. Au
Céramique, près des thermes d’Antonin, P. Gauckler
retrouva en 1901 les fours de potiers encore pleins des objets dont
l’artisan n’avait pu achever la cuisson : on
préparait la fête de Déméter ; des
milliers de boulets de catapulte ont été recueillis,
mêlés à des balles de fronde.